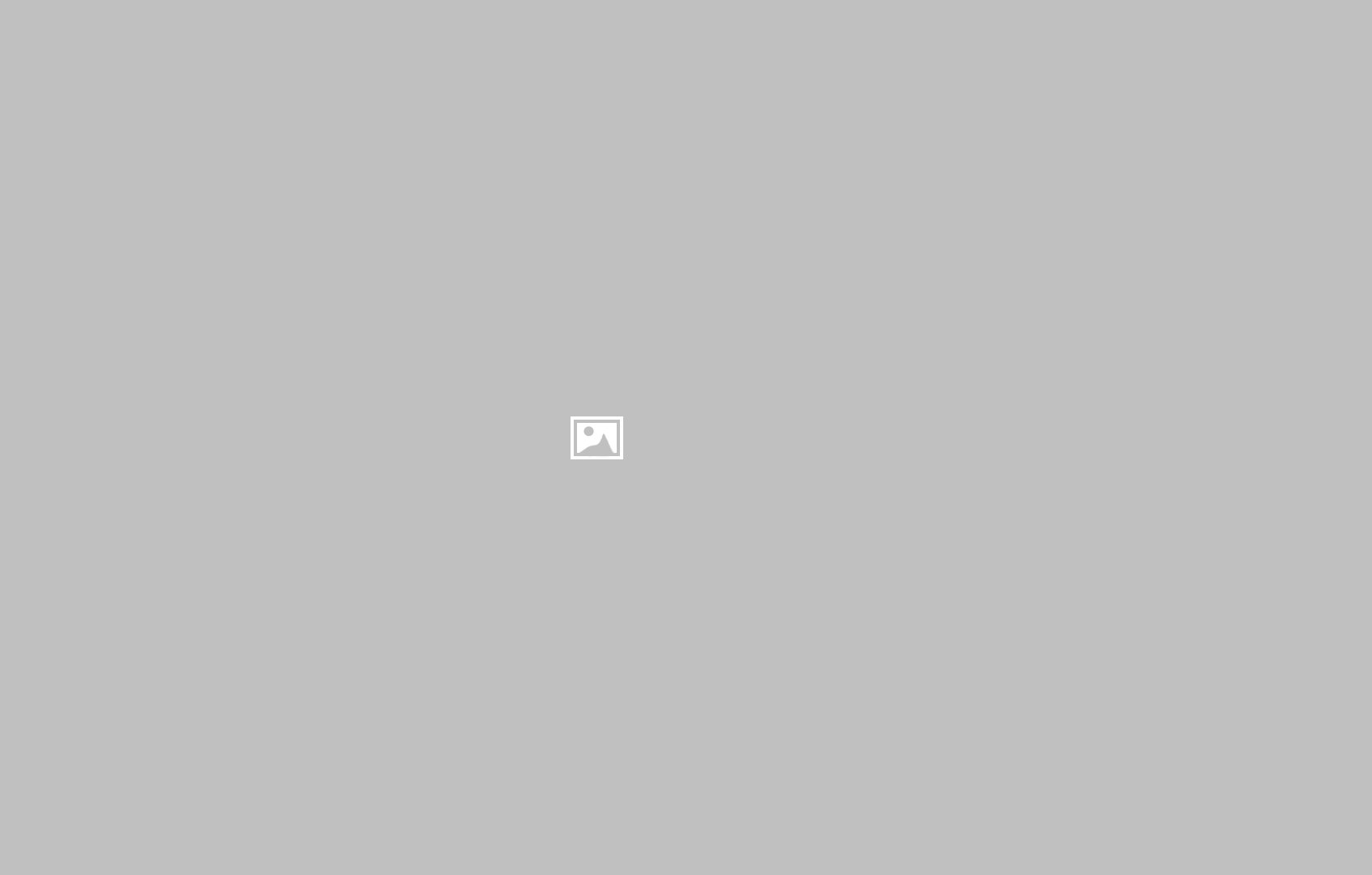Les gares, de Nyckie Alause
Piste d'écriture: une photo tirée du film de Chantal Akerman "Les rendez-vous d'Anna"
Sur le quai (photo tirée des Rendez-vous d’Anna, 1978)
Longtemps, Anna a hésité avant de se décider à bouger. Jusqu’à ce que le bruit des pas et des conversations s’amenuise jusqu’à disparaitre, elle faisait semblant de dormir. Par les portes automatiques béantes aux extrémités des wagons l’air glacé traverse les couloirs en sifflant, la faisant frissonner, apportant du dehors l’air humide, chargé du goût âcre des fumées de Paris une nuit d’hiver. Elle s’attarde, encore un peu, encore. Sur le quai maintenant déserté passe un véhicule suivi de remorques à bagages bringuebalantes et vides avant de disparaitre comme avalé par les lumières pâles de la gare, au loin.
Anna regarde le cadran de sa montre et se dit qu’elle aurait dû, avant de partir, changer pour l’heure de Paris. Maintenant elle hésite, une heure de plus ou une heure de moins, elle ne sait plus voilà tellement longtemps qu’elle est partie qu’elle a oublié les mécanismes.
— J’aurais pu régler cela avant, à l’aéroport de Düsseldorf.
Sa voix ne produit pas d’écho, elle se mêle à l’air glacé et s’efface, petit nuage de respiration que personne ne respirera. La dernière phrase qu’elle a prononcée avant cela était à l’intention du contrôleur qu’elle a remercié en reprenant son billet.
— Madame… a-t-il dit en le lui rendant.
— Merci…
Où l’a t-elle rangé ? Glissé dans la poche de sa veste, dans son sac de voyage comme pour s’en débarrasser ? Servi de marque-page dans ce roman qu’elle a fait semblant de lire avant de faire semblant de dormir ?
— Ma vie de faux-semblants dit Anna avant d’entrebâiller le rideau jaune qui masque partiellement sa vision du quai.
Elle a failli sourire, mais ses traits se sont figés. Une ombre longue et grise précède le clignotement des lampes intérieures qui se figent dans un mode veilleuse. Tout à coup, l’urgence l’étreint. Elle a l’impression d’un piège qui se referme. L’imminence d’une disparition prochaine.
Les anses de son sac lui paraissent tièdes au creux de sa main, presque amicales, et le sac d’une légèreté rassurante. Débarrassé du superflu, de l’encombrant et du toxique.
Elle fait glisser la porte du compartiment et marche, marche à petits pas comme pour profiter du temps, jouir du paysage, se charger du bonheur de respirer l’air du large, comme si elle entamait une promenade maritime avant de rentrer se réchauffer dans sa cabine transatlantique. Une traversée. Elle ne compte pas ses pas, elle les raccourcit et comme si elle avait oublié quelque chose ou s’était trompée de chemin, elle fait demi-tour, revient vers le siège qu’elle a quitté, passe la main dessus en caresse et mesure le creux et la tiédeur que son corps y a inscrits. Elle vérifie semble-t-il que ce n’est pas un rêve, qu’elle existe, c’est cela. En quelque sorte, elle vérifie qu’elle existe. Est-ce que ce geste la rassure ? Ou retarde-t-elle l’instant où elle descendra sur le quai ?
Anna reprend son souffle et d’un pas devenu énergique elle rebrousse chemin, remonte le couloir, met la main sur la poignée et le pied sur la première marche.
Non, ce n’est pas l’ombre portée d’un lampadaire, non plus un agent d’entretien qui opère un contrôle, pas un passager égaré ou clandestin, pas une ombre.
C’est ELLE.
Comment a-t-elle su qu’Anna viendrait ce soir, qu’Anna descendrait de ce train, qu’Anna finirait par rentrer.
Elle ne l’a pas su à proprement parler. Elle n’est pas venue régulièrement, mais de temps à autre il lui a semblé que le bon moment serait aujourd’hui-même. Et des aujourd’hui comme celui-ci, elle en a vécu beaucoup. Quelque chose dans la couleur ou du manque de couleur du ciel de fin d’après-midi, un vent glacial qui souffle de l’est, les cris désagréables des corneilles dans les arbres du square. Chaque fois, elle a passé son manteau au col de fourrure qu’Anna lui avait offert, son sac à main tellement chic qu’Anna lui avait offert, et le foulard… Quelques fois elle a oublié le foulard et elle s’est dit que c’était à cause de cet oubli qu’Anna n’était pas descendue de ce train-là, que ce ne devait pas être le bon jour et que si elle avait dû descendre de ce train elle ne l’aurait pas reconnue, et que ceci et que cela. Toujours elle avait trouvé à Anna des raisons en forme d’excuses et ainsi elle était moins malheureuse de son absence.
Anna se fige. Elle aurait bien envie de sourire, elle s’en sait capable, dans le wagon elle s’est comme, exercée. Poser un pied de plus sur la marche suivante ne devrait pas se poser comme un dilemme — la grille métallique du marchepied est luisante d’humidité. Elle pourra toujours se défendre de cette hésitation par sa peur de glisser.
Il suffirait de rien pour que la situation se dénoue. Prononcer juste un mot et tant pis si ce n’est pas le bon.
— Anna, fais un dernier effort, s’il te plait, je n’en peux plus d’attendre. Mes doigts se crispent sur les touches de mon clavier, je sens ce courant d’air froid qui m’étreint, l’odeur de fer et d’étincelles refroidie, les relents de moteur diesel, le tabac froid, et jusqu’au parfum de naphtaline du manteau à col de fourrure. J’entends le bruit de la soie qui se froisse, et le parfum ancien qu’elle ne met que pour la Gare du Nord. Je t’en supplie, Anna.
Là-bas, tout au bout du quai, là où se trouvent les ateliers de maintenance, un groupe d’hommes en salopette apparait. Ils parlent haut en roulant derrière eux des chariots aux roues bruyantes dans lesquels des outils s’entrechoquent.
C’est Elle qui cède la première. À sa soudaine détermination, on comprend qu’elle en a l’habitude, l’habitude de ces vaines attentes. La voilà qui tourne la tête vers le convoi des travailleurs, et comme si elle reprenait ses esprits, échappant au regard hypnotique du train, elle regarde encore une fois Anna et se retourne, pour partir.
Voilà Anna, tu as encore raté le coche !
Dépêche-toi ou il sera trop tard, une fois de plus.
Anna, quitte enfin ce train !
C’était peut-être pour sa dernière fois !
Rattrape-la, rentre chez toi !
***
Les gares en-dedans, en-dehors, en-deçà, au-delà, ont toutes la même odeur de crasse. Quand tu te penses seul, qu’il n’y a personne, que tu arpentes, tes pas se perdent dans une vanité presque cosmique qui ne te ramène que chez toi. Les gares en face-à-face, le monde en vis-à-vis, et nos pas en écho du temps.
Avant il y avait des bancs où l’on pouvait s’asseoir. Il y avait des mégots finissant de se consumer sur les pierres du ballast. Les bagages n’avaient pas de roues et leurs sangles nous mordaient les épaules. Rappelle-toi de ces fenêtres qui glissaient sur la nuit.
Les allers et les retours ne sont que les cliquetis de la même horloge, une régulation de courants telluriques, qui s’entrecroisent, s’envolutent, dont les couleurs ont peine à se mêler, où la force gravitationnelle s’oppose à la force électromagnétique, où le verre et le fer fondent dans le même creuset.